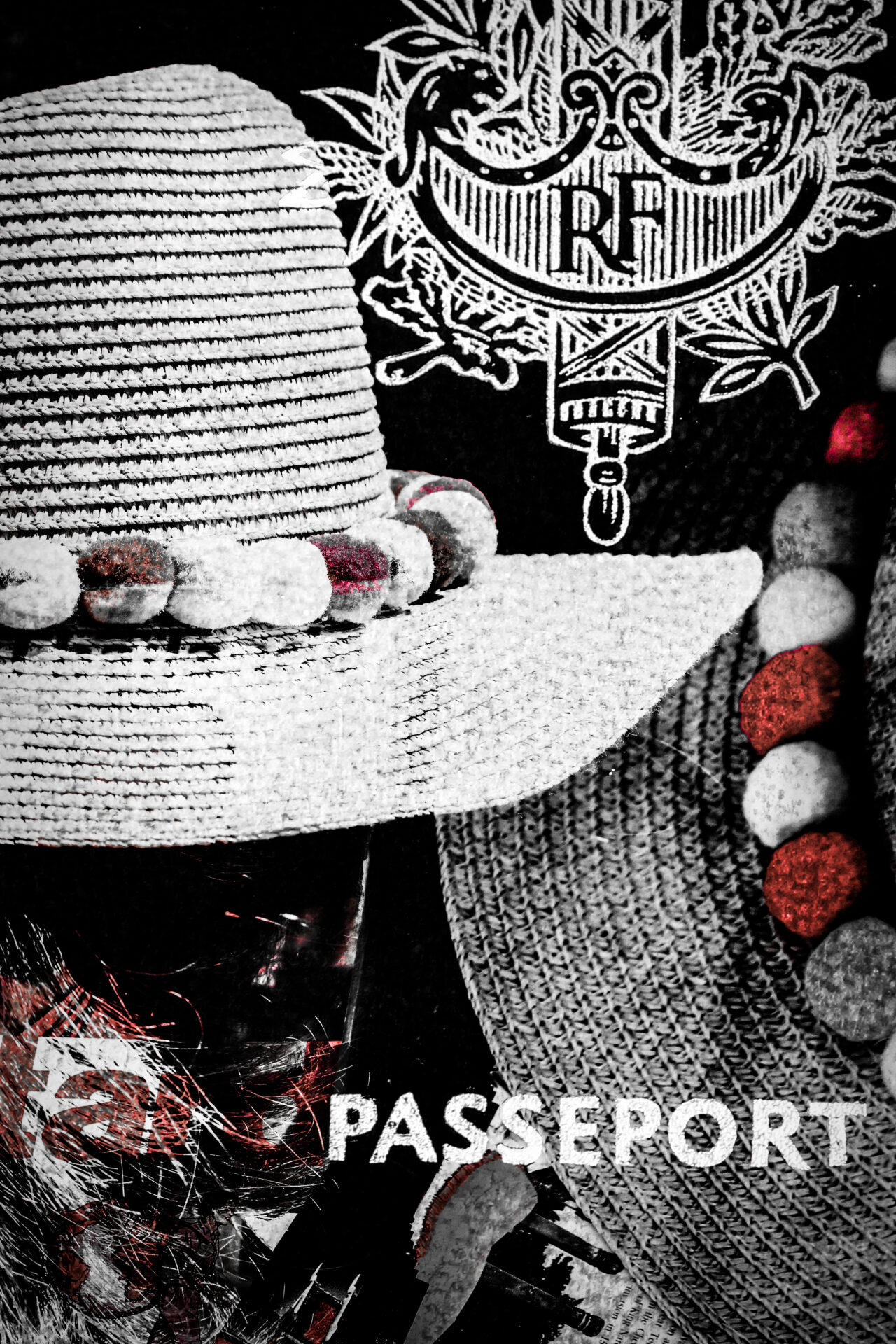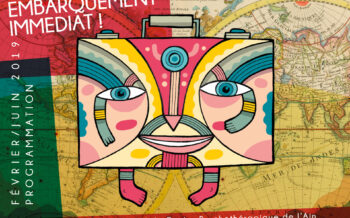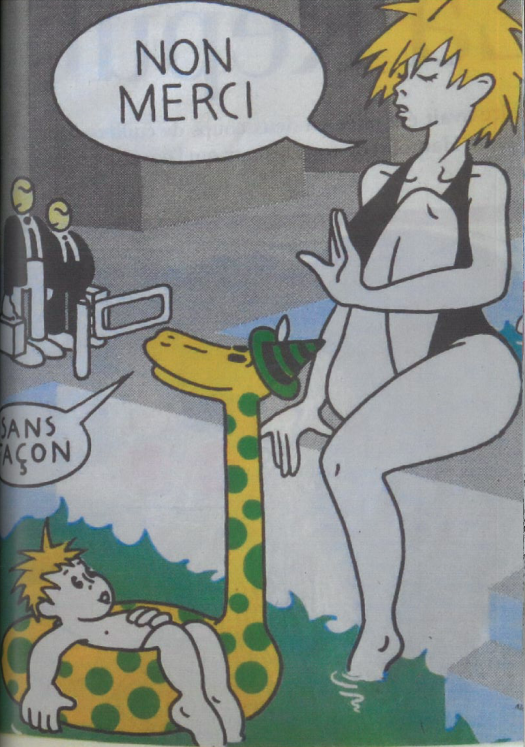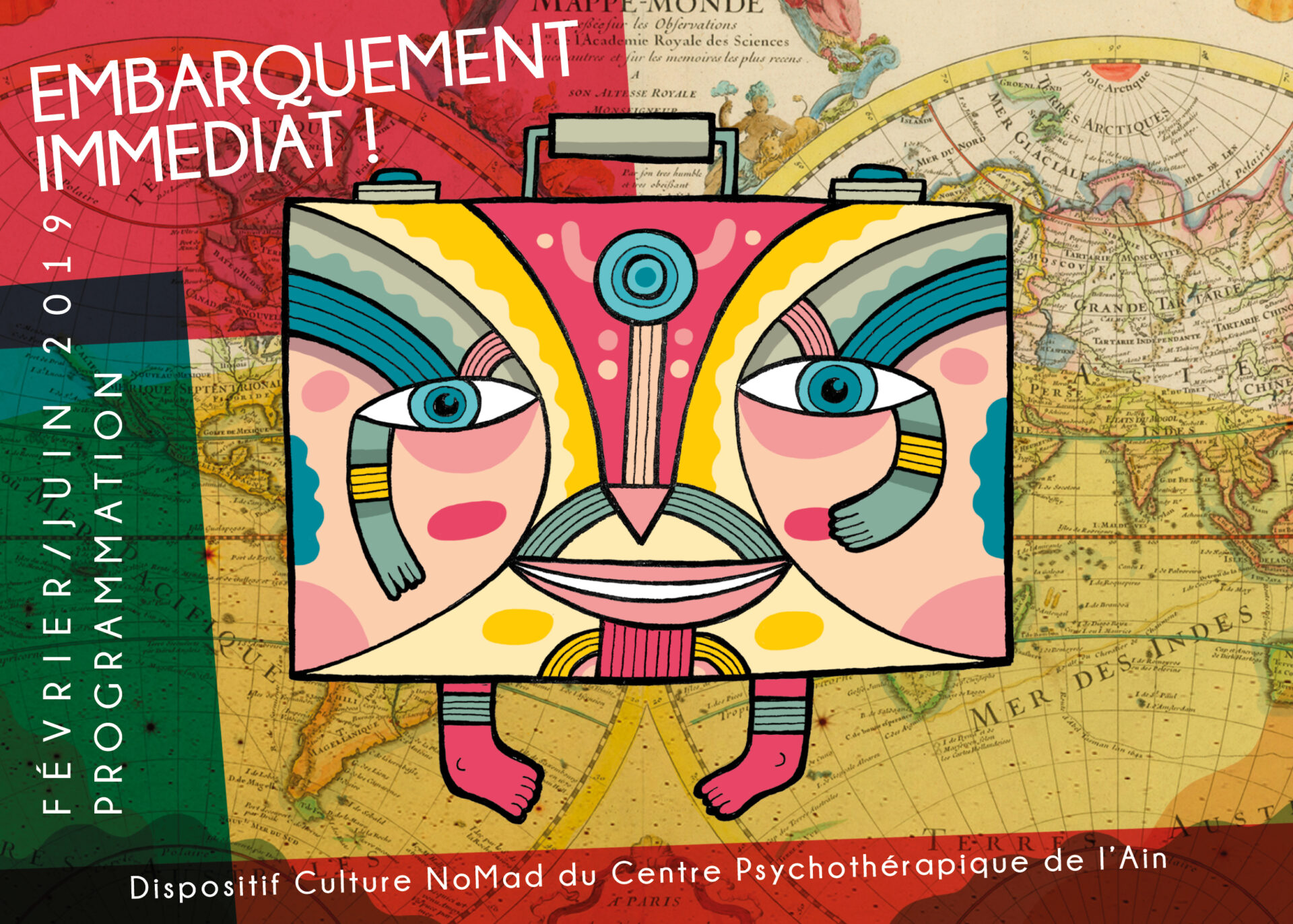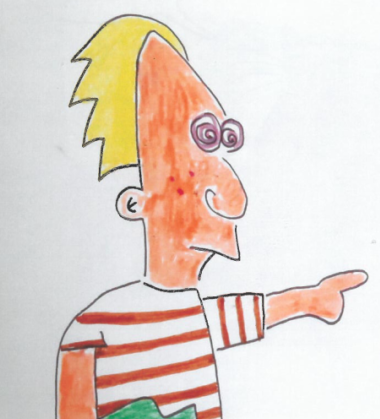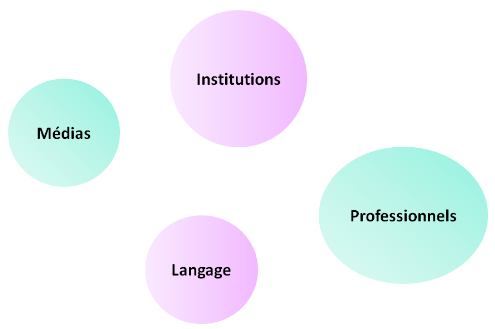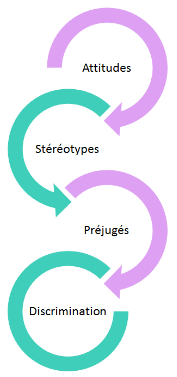Ce site est participatif !
Si vous souhaitez contribuer, quelle qu’en soit la manière, contactez-nous.
Projet Graines de pop-up CATTP IJ Ambérieu – copyright Joelle Belfy PhotoClub Bressan – Culture NoMad CPA 2017
L’argent fait-il le bonheur ?
Une revue de la littérature élaborée par Diener et Seligman met en avant que l’argent est un substitut inexact du bien-être. En effet, selon l’OCDE, le Produit Intérieur Brut est une mesure imprécise du bien-être, et les indicateurs économiques et sociaux ne sont pas suffisants pour mesurer le bien-être.
Plusieurs études ont montré un effet du revenu sur le bien-être subjectif. Selon les auteurs à l’origine de ces études, l’argent contribue au bonheur. Toutefois, cet effet reste très modéré si la personne se situe au-dessus du seuil de pauvreté, c’est-à-dire quand il peut subvenir à ses besoins primaires.
De plus, d’autres variables peuvent avoir un effet sur le sentiment de bien-être, même si l’individu se situe en-dessous du seuil de pauvreté (par exemple la qualité des relations sociales), ce qui explique pourquoi certaines personnes en situation de précarité ressentent un sentiment de bien-être plus ou moins élevé.
Le paradoxe d'Easterlin
Le paradoxe d’Easterlin a prouvé que l’augmentation importante du revenu dans les sociétés occidentales n’est pas forcément accompagnée d’une hausse du sentiment de bien-être subjectif.
L’effet du revenu sur le bien-être est davantage significatif dans les pays pauvres plutôt que dans les pays riches.
Comme le précise Shankland (2019), « les recherches portant sur le lien entre sentiment de bonheur et possessions matérielles indiquent que l’amélioration du bien-être liée aux ressources financières serait particulièrement effective lorsqu’elle s’accompagne d’une meilleure réponse aux besoins fondamentaux tels que définis selon la théorie de l’autodétermination. Pourtant, un certain nombre d’études montrent que les personnes ayant plus d’argent en profitent pour acheter des biens ou réaliser des activités qui ne produisent qu’un mieux-être éphémère. De plus, la richesse réduirait l’aptitude à savourer l’instant présent ».